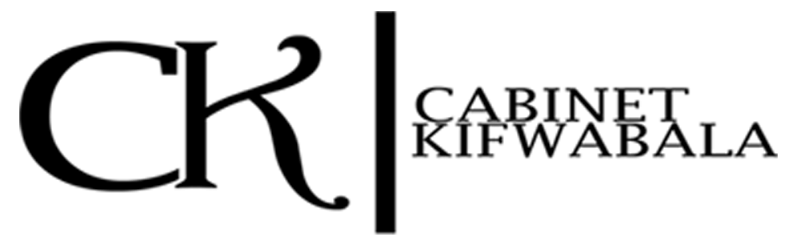
En droit congolais, il y a des différences essentielles entre les droits réels qui portent sur le sol, immeuble par nature, et ceux qui portent sur les autres biens immeubles et meubles. Cette différenciation a conduit à concevoir l'ouvrage consacré à l'étude du droit portant sur les biens, en deux tomes. Le tome 1 aborde ainsi les droits réels fonciers. C'est donc à l'analyse de la loi dite foncière c'est-à-dire la loi du 20 juillet 1973 telle que modifiée en 1980 que se livre cet ouvrage. En toile de fond se trouve aborder la question suivante : cette loi traduit-elle la représentation multiséculaire qu'ont les congolais de leurs rapports avec le sol ? C'est pourquoi l'ouvrage se livre d'une part à l'étude des droits fonciers congolais avant la loi foncière de 1973 c'est-à-dire droits fonciers des communautés traditionnelles, droits fonciers à l'époque coloniale ; d'autre part à l'étude du droit foncier positif congolais c'est-à-dire celui consacré par la loi de 1973.
La loi n° 087 du 1er août 1987 « dite code de la famille » qui est entrée en vigueur le 1er août 1988, représente une des plus grandes reformes réalisées par le législateur congolais post colonial. Elle a eu pour but d'unifier et d'adapter les règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille à la mentalité congolaise. Cet ouvrage réalisé une analyse globale des dispositions consacrées par cette loi en matière d'incapacité, de la famille et des personnes. On y trouve les règles relatives à la personnalité juridique des êtres humains et à la personnalité morale, les règles qui concernent la capacité d'agir des personnes. On y trouve également les règles relatives à la vie d'un coupe (mariage, divorce, séparation conventionnelle et même l'union de part) à la vie de l'enfant (la filiation, l'adoption, l'obligation d'entre et d'éducation). On y trouve enfin, les règles sur la parenté et l'alliance.
Régimes matrimoniaux, succession et libéralités : tels sont les thèmes traités dans cet ouvrage. Il constitue le droit patrimonial de la famille. En effet, les hommes dans leur grande majorité et particulièrement les congolais, sont concernés par le mariage, avec tout ce qu'il engendre comme bonheur et difficultés notamment concernant les biens des époux. En même temps, les hommes sont aussi confrontés un jour au décès d'un proche. Et lorsqu'une personne est décédée, son patrimoine n'est pas détruit mais se transmet. Se pose alors diverses questions quant à la succession du défunt. Qui va hériter ? Que va-t-il hériter ? Que faire pratiquement ? Comment procéder ? Par ailleurs, plusieurs personnes songent à organiser elles-mêmes cette transmission dans la perspective de leur propre décès. Est-il possible de le faire ? Quelles sont les formalités à observer dans cette hypothèse ? Qu'en est-il alors des libéralités qu'elles peuvent consentir notamment par des dispositions de dernière volonté ? N'y-a-t-il pas des règles à observer, à respecter en la matière ? Depuis la loi n° 87010 du 1er août 1987 portant code de la famille, le législateur congolais a répondu à la quasi-totalité de ces questions. Le présent ouvrage essaie de réaliser une analyse globale des dispositions qui ont été prises. Il expose ainsi clairement le droit en vigueur en RD Congo, et propose des informations précises. Par un exposé assez simple et accessible, il veut aider à la compréhension d'une matière souvent perçue comme complexe.
Le secteur de la justice est le pilier le plus important de l’Etat de droit pour toute société. Dans une société post conflit, il joue un rôle supplémentaire. Il est un gage de stabilité et de paix : son incapacité de véhiculer, de promouvoir, garantir et protéger les valeurs d’équité et de justice peut faire basculer à nouveau dans l’anarchie et les troubles sociaux toute société qui émerge d’une situation de conflits. Mais le secteur de la justice ne pourra efficacement répondre à ses fonctions qu’à la condition que l’Etat se soumette à la règle de droit. En République Démocratique du Congo, la restauration et la consolidation de l’Etat de droit passe par le renforcement de l’indépendance et de la responsabilité des magistrats, la rationalisation de l’aide public au développement dans le secteur de la justice et surtout une bonne planification de la réforme de la justice. L’ouvrage décortique l’ensemble de ces problèmes et ambitionne de contribuer ainsi à la définition des politiques nationales visant à les résoudre.
En 2004 était publiée la première édition de ce livre qui fait l’analyse des droits réels fonciers partant de la loi dite foncière c'est-à-dire la loi du 20 juillet 1973 telle que modifiée en 1980 que se livre cet ouvrage. En toile de fond se trouve aborder la question suivante : cette loi traduit-elle la représentation multiséculaire qu'ont les congolais de leurs rapports avec le sol ? C'est pourquoi l'ouvrage se livre d'une part à l'étude des droits fonciers congolais avant la loi foncière de 1973 c'est-à-dire droits fonciers des communautés traditionnelles, droits fonciers à l'époque coloniale ; d'autre part à l'étude du droit foncier positif congolais c'est-à-dire celui consacré par la loi de 1973. La deuxième édition qui prend en compte les divers développements intervenus depuis lors tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, est plus étoffée que la première.
Le tome 1 était consacré aux droits réels fonciers. Le tome 2 est consacré aux droits réels immobiliers et mobiliers. Les premiers sont des droits portant sur les biens immeubles par incorporation c’est-à-dire les biens directement incorporés au sol soi naturellement soit artificiellement. et les autres sur les biens meubles.